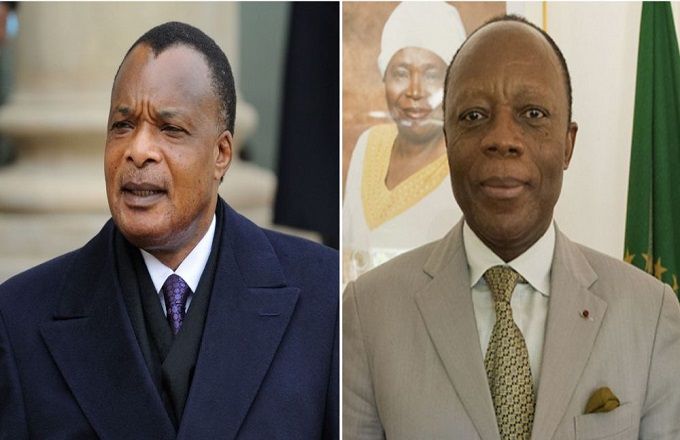Pour survivre aujourd’hui à Makabana dans le Niari (sud), plusieurs jeunes se débrouillent en exerçant diverses activités, le plus souvent en dehors des lois et du fisc. Le quartier Migouéguélé n’échappe pas à ce constat. Il connait un essor fulgurant de nouveaux métiers de la débrouille temporaires et changeants. Ces petits métiers salutaires ne naissent pas seulement comme conséquence des exigences de survie et comme résultat de l’inventivité des jeunes de l’ex cité Comilog, mais surtout comme expression d’une bonne aptitude à saisir les besoins de l’usage. L’un des derniers métiers créés par l’ingéniosité et l’inventivité des jeunes est la vente de carburant (essence, gasoil et pétrole) sur les voies publiques. Les conditions de son émergence et la fulgurance de son développement font penser à l’émergence d’un filon qui constitue aujourd’hui une source de revenus pour des centaines de jeunes désignés dans le cadre ce travail sous le néologisme « Khadafi ». Ils sont aussi vulcanisateurs et cordonniers…

Dans le département du Niari, on assiste désormais à l’émergence d’un nouveau filon de l’économie de la débrouille dans la ville de Makabana. Ils sont là dans tous les quartiers, et ils vous abordent sans complexe. Ils ont entre 10 et 25 ans, et ils gagnent leur vie par de petits boulots. Ils sont cireurs de chaussures, porteurs de colis. D’autres sont marchands ambulants, vulcanisateurs, cordonniers, « Khadafi ». Ils vendent de tout : des fruits, des médicaments (souvent contrefaits), des cigarettes, de l’eau fraîche…
Ils sont laveurs de pare-brise ou de voiture, marchands de sables en pirogue, casseurs de cailloux… Ce sont les petits métiers de la rue.
Certains vendent pour leur propre compte, d’autres, pour le compte d’un commerçant ou d’un parent.
Il existe comme un plan de carrière des petits métiers : on commence par être balayeur ou porteur pour acquérir un petit capital, puis on est cireur ou vendeur.
Beaucoup de cireurs deviennent ensuite réparateurs de chaussures ou cordonniers. Mais, confiants en leur métier, ils caressent le rêve de devenir de grands commerçants.

Comme dans beaucoup de villes congolaises aujourd’hui, on ne va pas au supermarché faire ses courses. On se déplace simplement dans la ville, et on croise les marchands ambulants, car tout se trimbale, et tout se vend. L’économie informelle s’est imposée comme la première source de revenus pour ses habitants. La rue est devenue le terrain du commerce en tout genre. Vitrine de l’informel, trottoirs et chaussées sont le creuset de toutes les ressources humaines.

Aujourd’hui, deux citadins sur trois vivent de l’activité de la débrouille. Chacun peut trouver une place et construire son “business”. C’est pour beaucoup la seule manière pour survivre dans une société en plein développement économique et bousculée par les inégalités.

Cette économie parallèle est surtout répandue parmi les classes les plus pauvres qui ne bénéficient d’aucune protection sociale. Les petits vendeurs n’ont ni les droits des travailleurs ni ceux des enfants et passent à côté de tous les services de base (santé, loisirs, formation scolaire et professionnelle). Ils vivent dans l’indifférence générale et parfois l’exploitation organisée comme les petites employées de maison, les enfants mendiants qui travaillent pour le compte de leurs parents.
Plusieurs jeunes congolais ne se contentent plus de satisfaire aux exigences de leur famille. Ils ont des aspirations personnelles. Ils veulent s’épanouir, décider de leur vie et être impliqués dans son orientation. Ils cherchent à comprendre les choses, à découvrir d’autres horizons, à donner un sens à leur vie. Tout cela provoque l’émergence de nouvelles cultures urbaines. Le potentiel créatif de l’adolescence se trouve libéré en ville.

Les vendeurs désirent devenir commerçants. D’après eux, la plupart des grands commerçants ont d’abord été de petits vendeurs comme eux. Certes, des enfants sont apprentis, placés dans les ateliers de menuiserie, mécanique, soudure, électricité, sculpture et maçonnerie pour les garçons ; couture pour les filles ; le plus souvent par leurs parents moyennant finances. Mais ils passent le plus clair de leur temps à faire des tâches annexes (courses, nettoyage), ils n’apprennent pas grand-chose.
Les revenus ont généralement trois destinations. La plus grande partie doit aider le budget quotidien des familles (nourriture, loyer, participation aux frais de scolarisation des frères…). Une autre part couvre les besoins ordinaires des enfants. La dernière tranche est destinée à l’épargne, souvent confiée à un parent ou un adulte du milieu de travail, quand ils en trouvent un digne de foi.
Les vendeurs ont souvent des difficultés à mobiliser un fond de départ pour acquérir les marchandises. Certains ont la chance de trouver des semi-grossistes qui leur avancent un premier lot de marchandises pour démarrer. Les autres sont obligés de vendre pour le compte d’un autre commerçant en espérant ainsi réunir l’argent nécessaire au lancement de leur propre affaire.
Peut-on continuer à regarder comme des ratés des gens qui sont indispensables au quotidien, qui font régulièrement le changement’ (changer un billet en monnaie), qui entretiennent plus que convenablement des familles ?
Arrêtons de qualifier certains métiers de “petits’”. En quoi les autres métiers qui ont eux aussi leurs servitudes sont-ils plus valeureux que les métiers dits petits ? Si ce n’est qu’une affaire de diplômes, il peut y avoir des diplômés pour tous les métiers : couturière, vendeuse…
Quelle est cette société où tout le monde devrait être ministre, savant, docteur ?
Comment peut-on juger la multiplication des petits boulots comme des échecs, alors que ce sont des réponses à des demandes sur le marché de nos besoins ?
Des besoins sociaux sont ainsi comblés, qui n’auraient pu être satisfaits autrement, au même moment, avec la même efficacité.
Jean-Jacques Jarele SIKA / Les Echos du Congo-Brazzaville