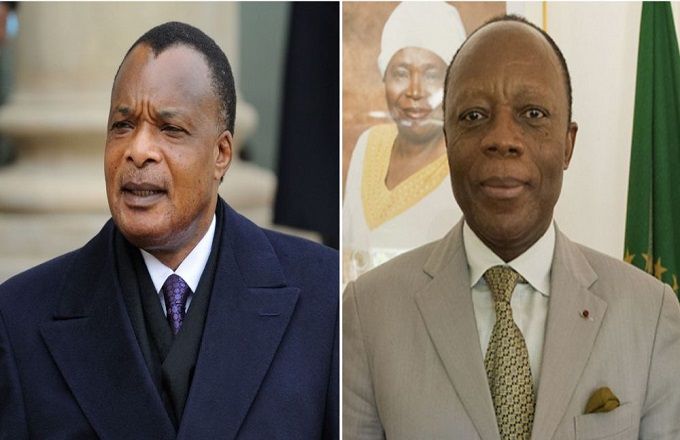Mam’néné Zenti et Nti Pouabou, deux personnages qui m’ont fait aimer les thrènes. Mon âme les remerciera toujours. Le premier, c’est Mam'néné, qu'enfants, nous appelions, affectueusement, Madame Zentie, au lieu de Madame Gentille, parce qu'elle prononçait ce Z à la place du G.
Mam'néné était la première épouse de Mahoungou mâ Mboungou, l'oncle de mon père Kiongo-Niaty Léonce, lui-même, fils de Tsatsa-Mboungou, sœur de Mahoungou mâ Mboungou, le patriarche du clan Bahungana, du village Kifimba.
Mam'néné était une femme exceptionnelle, du fait qu'elle faisait partie du cercle fermé de ces femmes-pleureuses, à l’image des griots, capables de retracer l'histoire des familles et des clans frappés par le deuil. Et c'est en pleurant, à travers les évocations (bibembos na bitolos, en langue kuni), que ces femmes pleureuses, retracent la saga généalogique des clans de la famille éplorée.
Enfant, j'avais vu Mam'néné, Madame Zentie, excellait dans cette performance, qui la faisait entrer au pinacle de son art. En l’écoutant, les participants à la veillée mortuaire, prenaient la mesure du parcours de vie d’un Être chéri disparu à jamais. L’évocation de l’existence passée, du défunt ou de la défunte, ouvrait un portail dimensionnel qui menait au divin.
Cependant, l’amour du Créateur, omnipotent et omniscient, devenait insaisissable et troublant à travers les questionnements des pleureuses : pourquoi la mort ?
C’est à travers ces pleurer-chanters que Mam’néné disait des paroles de connaissance des clans et de reconnaissance de l’amour du Créateur à sa création. Des paroles reprises en chœur dans le cercle de pleureuses chanteuses, accompagnant l’âme, qui avait quitté le corps physique, pour s’en aller à Mpemba, sur les ailes des airs déclamés par des voix de femmes chargées de chagrin.
Gloire au Créateur pour avoir paramétré la femme à être le véhicule, par excellence, de la transmission au monde de la nature divine, tout à la fois, douce, et apparemment, faible, mais combien puissante parce qu’elle est un canal de vie.
Le second personnage, qui me fit entrer dans l’univers des humanités classiques africaines, est un professeur de littérature. Il s’appelait Félix Nti Pouabou. J'étais en classe de Seconde, au lycée Karl Marx (actuel Victor Augagneur), dans la ville de Pointe-Noire.
J’avais assisté à un de ses cours, bien que je ne fus pas un élève des classes qu'il prenait. Je fis cette entorse à la règle administrative, parce j’avais entendu des échos favorables à son sujet dans le bahut. Le personnel enseignant, tout comme les élèves étaient unanimes : il était un bon professeur de la matière qu’il enseignait.
Alors, ce jour-là, jai séché le cours de math de mon professeur titulaire pour aller prendre place dans la salle de classe où se trouvait Félix Nti Pouabou. Je l'ai écouté parler de la littérature africaine. Il parlait de ces femmes pleureuses des sociétés traditionnelles africaines. Lorsqu'il développait son analyse, j'étais de corps avec eux dans la salle, mais mon esprit avait rejoint Maniémo, mon village natal.
Et là, je revoyais Mam'néné, Madame Zentie, la matriarche de notre famille, en train de conduire la rythmique d'une veillée mortuaire. Elle était l’archétype de ces femmes griottes que décrivait, Félix Nti Pouabou, le professeur de littérature africaine.
Il utilisa le terme de thrène, pour nommer ces pleurs en chansons, ces chants en pleurs. Thrène, le mot exact pour désigner ces lamentations funéraires venues du fin fond de la culture africaine, récupérées, au passage du temps, par la Grèce Antique, mais qui n'ont jamais quitté la structure sociétale africaine, toujours psalmodiées, en pleurs chantés, dans les veillées mortuaires des Africains et des Afro-descendants dans les diasporas.
D'ailleurs, je me souviens, comme si c'était hier, il fit un lien, évident, entre les thrènes et le Blues, cette musique venue de l'âme des Africains déportés et esclavagisés dans les champs de coton, de tabac et de canne-à-sucre, dans les Amériques.
Comment ne pas être reconnaissant de ce que cet éminent enseignant de littérature africaine a ajouté à mon bagage culturel. Ce qu’il m’avait transmis, ce jour-là, était hors de portée marchande. La valeur ajoutée à mon esprit, fut inestimable. C’était plus que de l’argent. Et c'est cela, l'Économie de la connaissance : car elle est toujours à Somme positive.
Pour m'avoir transmis ce nouveau mot, qui m’ouvrait à la l’entendement et à la compréhension d’un nouveau concept, Félix Nti Pouabou avait renforcé les schèmes de raisonnement et d’organisation cognitive de mon cerveau. Ce concept ne pouvait plus jamais s’effacer de ma mémoire. Pourquoi ? Parce qu’un cerveau, qui acquiert de la connaissance et qui la transmet à un autre cerveau, ne s'appauvrit jamais. Bien au contraire, il s'enrichit en enrichissant d’autres cerveaux, qui enrichiront des cerveaux supplémentaires, pour générer un cerveau collectif puissant.
Michel Mboungou-Kiongo ancien DG de Télé Congo (1994-1997)