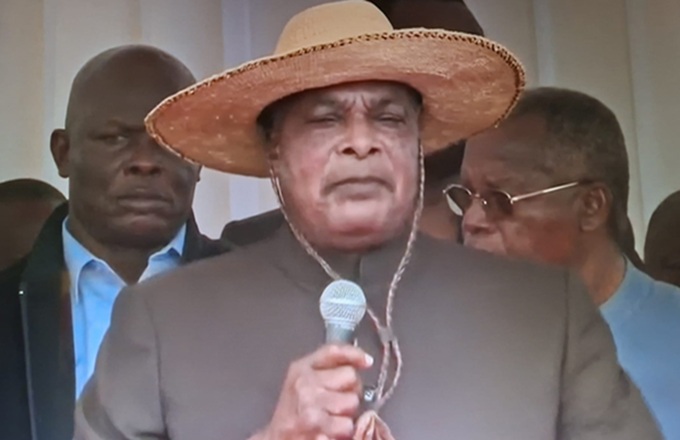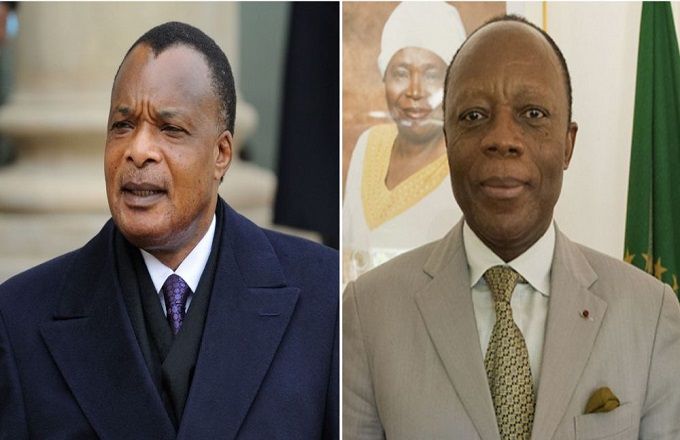Un récent rapport des Nations-Unies indique qu’en moyenne, une femme meurt dans le monde toutes les deux minutes de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement. Les chiffres appellent à davantage d’efforts pré et post natals, bien que la mortalité dans ces secteurs ait baissé ces vingt dernières années. Au Congo, les chiffres ne sont guère meilleurs, en dépit des mesures prises par les autorités sanitaires, pour résorber le phénomène.
Les derniers chiffres montrent une légère baisse de la mortalité des parturientes, mais celle-ci reste très importante. En 2020, 290 000 femmes sont décédées d’hémorragies graves, d’hypertension artérielle, d’infections liées à la grossesse, à l’accouchement ou à des avortements à risque, contre 309 000 en 2016.
Le rapport met en évidence des « régressions alarmantes » pour la santé des femmes ces dernières années, et un « revers majeur » dans plusieurs régions du monde. Certaines sont plus touchées que d’autres.
En 2020, 70% des décès maternels ont eu lieu en Afrique subsaharienne. Dans neuf pays affectés par de graves crises humanitaires, les taux sont doublés par rapport à la moyenne mondiale d’environ 230 décès pour 100 000 accouchements.
Trois facteurs majeurs : manque de soignants, de matériel et de suivi
La mortalité maternelle s’explique par le manque de soins, de matériel médical et de personnel. Environ 900 000 postes de sage-femmes font défaut, estime le rapport.
À cause des inégalités financières, d’éducation, ou raciales et ethniques, le suivi médical est défectueux dans bon nombre de pays : « près d’un tiers des femmes a moins de la moitié de huit contrôles prénataux ou ne reçoit pas les soins requis après l’accouchement », alerte le rapport.
La directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population, Dr Natalia Kanem, a déclaré qu’ « il est inacceptable que tant de femmes continuent de mourir inutilement pendant la grossesse et l’accouchement ».
Alarmées par ces données, les Nations unies invitent les États à mettre en place des actions pour viser un objectif de moins de 70 décès pour 100 000 accouchements d’ici à 2030.
Au Congo, le tableau n’est pas meilleur non plus. En 2022, le ratio de mortalité maternelle était estimé à 414 décès pour 100 000 naissances vivantes, tandis que celui des nouveau-nés s’élevait à 28,86 décès pour 100 000 naissances vivantes.
Même si le gouvernement a décrété la gratuité de la césarienne, encore qu’il faut qu’il faut avoir de kits disponibles, le problème reste entier car de nombreuses femmes surtout en milieu rural, ne bénéficient toujours pas d’un suivi prénatal conséquent. Parfois, c’est bien tard qu’une grossesse se révèle être à risque pour la mère ou le bébé.

Dans les grands centres urbains, l’appât du gain qu’anime certains personnels de santé fait parfois perdre un temps précieux pour la vie de la femme ou du bébé, surtout pour les grands prématurés.
Dans quasiment tous les hôpitaux du Congo, le service de néonatologie est réputé être celui qui enregistre le plus grand nombre de décès par jour. Entre manque d’oxygène et coupures d’électricité, certains jours sont vécus comme une véritable hécatombe, avec des taux de décès de plus de 70%.

Et cela devient affaire de chance, car tout dépend de sur qui on tombe, au moment d’aller accoucher. Quand on y ajoute le manque d’équipements ou encore les aléas consécutifs à l’humeur des soignants, l’accouchement reste sans conteste une question de vie ou de mort pour la maman et le bébé à naître.
Bertrand BOUKAKA/Les Échos du Congo-Brazzaville