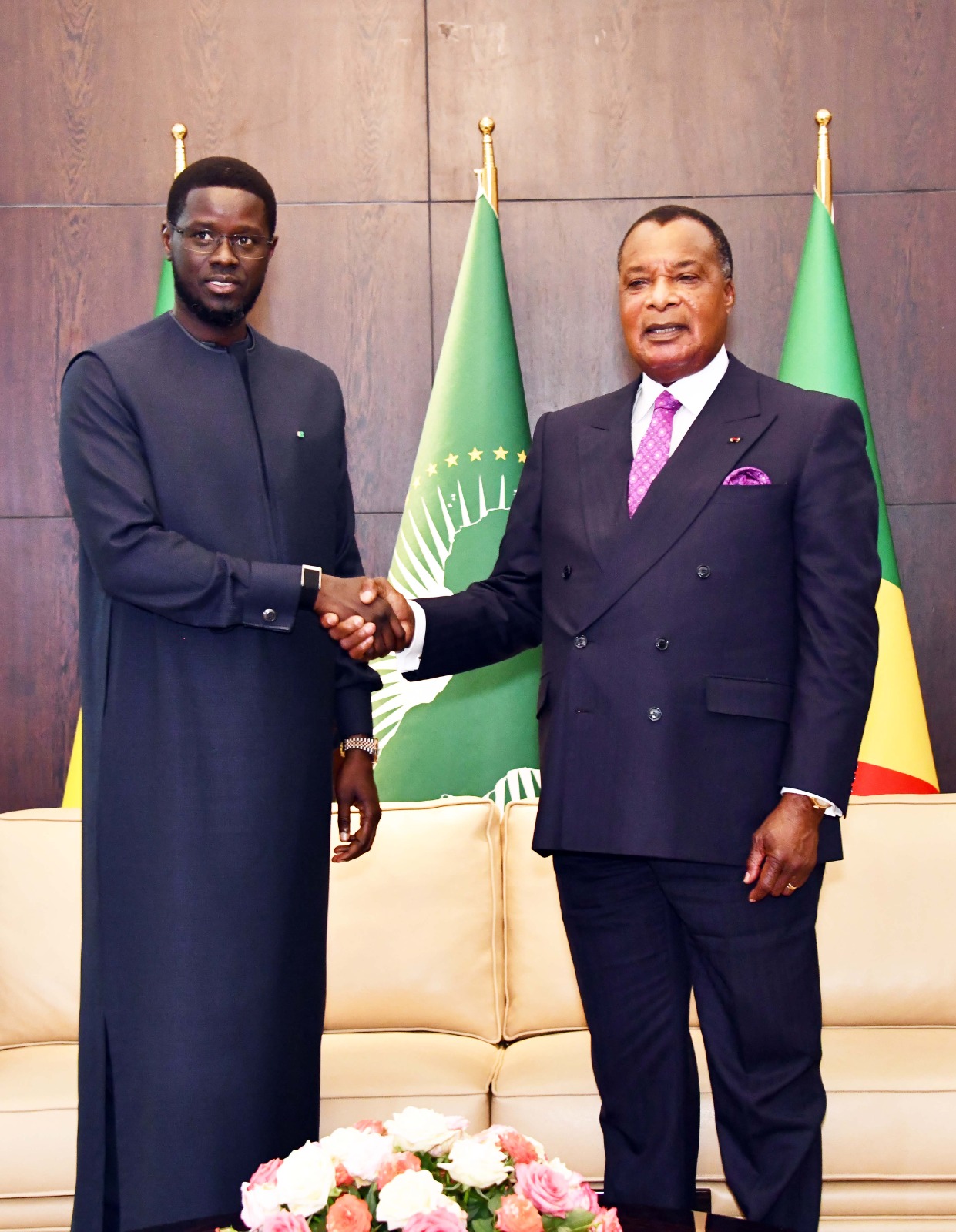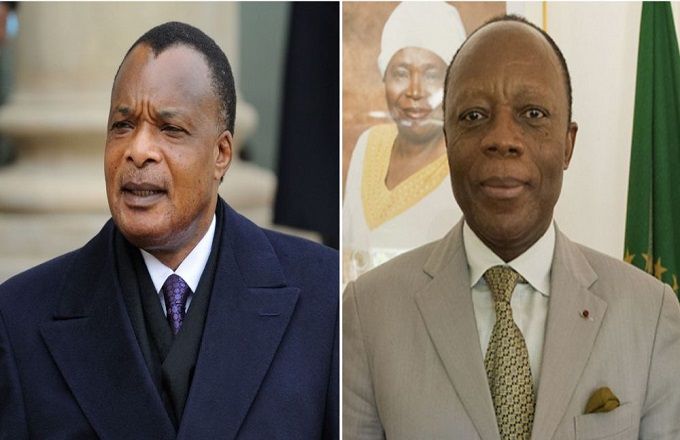De Gabriel Kinsa à Simbou Vili en passant par Thierry-Paul Ifoundza, Charlemagne Moukouta, Bruce Mateso, Christian Kader, Léandre-Alain Baker, plusieurs auteurs et écrivains d’origine congolaise se sont livrés à des séances de dédicaces sans temps mort aucun, sur les stands de leurs éditeurs, « Les Lettres Mouchetées » (Muriel Troadec), Paari (Mawawa), Wa’wa (Virginie Mouanda). Ambiances.

Loin de verser dans un jugement de valeur des plus insipides, le Salon du Livre Africain de Paris apparaît dès l’abord comme un événement ghettoïsant. Car oui, avec la mondialisation et les réseaux sociaux, se pose la question de l’altérité de l’art.
Faut-il parler d’artistes africains ou d’artistes d’Afrique, d’art africain ou des arts d’Afrique ? Du livre africain ou du livre d’écrivain écrivain ?

Parler d’un Salon du Livre Africain, c’est de facto l’isoler de celui du reste du monde, du moins le cataloguer comme un art à part. Or il n’existe que des artistes, et donc des auteurs et des écrivains d’Afrique, dont l’œuvre n’est pas uniquement destinée aux Africains. Il existe peut-être un « art africain », à l’image de ce dont parlait Picasso : « l’art nègre » ! Mais les mots du célèbre peintre renvoyaient moins à un art primitif, fétichiste qui jaillit exclusivement des « Africains » qu’à sa qualité, voire à ses propriétés magiques et non à ses origines.

Ousmane Sow est devenu célèbre parce qu’il a refusé la pureté. Il y a en lui des tendances « gréco-africaines » : l’artiste sénégalais s’est inspiré des photographies de Leni Riefenstahl réalisées chez les Nubas. Son inspiration lui vient également des sculpteurs tels Rodin, Bourdelle, etc.
Neuf livres sur dix, sinon la totalité des livres présentés à cette quatrième édition du Salon du Livre Africain de Paris, sont écrits en français. Ce qui veut dire qu’il y a quelque chose d’ailleurs dans l’art d’Africain. Ce qui lève le doute sur le destinataire : tout public francophone. Ou anglophone ou espagnol pour les livres traduits.
De fait, le livre n’est pas africain mais universel.

Il n’en reste pas moins que c’est dans ce genre d’événements que des écrivains invisibles tentent de sortir la tête de l’eau pour (enfin) se faire voir.
L’occasion pour les maisons d’éditions basées en Afrique de proposer leurs œuvres, mais surtout, d’attirer l’attention de potentiels partenaires. D’autant plus que la presse française et africaine était présente.

Du reste, une séance de dédicaces constitue toujours l’instant où tout auteur se rencontre et est face à lui-même. L’instant où son égo est flatté devant cet inconnu qui s’apprête à le découvrir.
Du 14 au 16 mars donc, dans la Salle des Blancs-Manteaux (Paris 4), il a fallu jouer des coudes pour se frayer un chemin. Si bien que l’espace a paru trop exigu pour contenir tous les visiteurs venus à la rencontre des auteurs et écrivains africains. Connus et méconnus – parfois à tort. Mais pas que ! Certains écrivains européens n’ont pas manqué cette occasion pour des séances de dédicaces, à l’instar du journaliste-écrivain Antoine Glaser.
Le stand des éditions Paari a vu se succéder Victor Bissengué, Christian Kader, Thierry-Paul Ifoundza, Charlemagne Moukouta, Gabriel Kinsa, sans oublier la présence remarquée de l’artiste-musicienne-écrivaine Simbou Vili.

Sur le stand des éditions « Les Lettres Mouchetées » que dirige Muriel Troadec, dont l’un des romans, « Le psychanalyste de Brazzaville », a remporté le Grand Prix Afrique et le Prix Orange 2023, ont été présentés au public les deux livres coécrits par Anna Maria Celli et Léandre-Alain Baker : « L’immaculée » (récit) et « Ce qu’il faut de sanglots » (roman).
En cette même occasion, a été remis le Grand Prix Afrique 2024 à l’écrivaine d’origine camerounaise Hemley Boum pour son roman « Le rêve du pêcheur » (Gallimard).
Vivement la 5e édition !
BB / Les Echos du Congo-Brazzaville