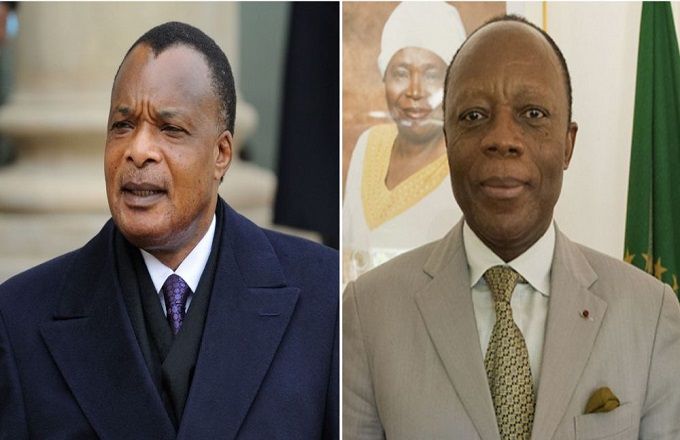Les impacts du réchauffement climatique se traduisent désormais par des changements inhabituels, qui bouleversent considérablement les phénomènes des saisons. Cette nouvelle donne marquée par un déchainement des éléments climatiques, prend souvent de court populations et pouvoirs publics submergés par la violence des phénomènes, faute de les avoir anticipés. Pourtant, alors que la nature lance des alertes récurrentes, même les gouvernants continuent d’attendre que le ciel nous tombe sur la tête, plutôt que de mener des études prospectives sur la façon de faire face à ces phénomènes de plus en plus violents qu’imprévisibles, mais dont une meilleure préparation pour y faire face, peut en atténuer les effets.
Produits au moyen de l’intelligence artificielle, des nombreux clichés aussi vrais que nature, présentent des villes congolaises sous la neige.

Si cette plaisanterie de « bon goût » déplace géographiquement le Congo, en le plaçant climatiquement dans l’hémisphère nord, pour simplement faire le buzz, ce génie imaginatif devrait pourtant pousser les uns et les autres à se poser les questions suivantes : « Et si cela arrivait réellement un jour, que fera-t-on ?
A-t-on dans nos différentes agglomérations, des structures adaptables, à même de protéger les populations les plus vulnérables, qui faute de moyens, ne pourront se prémunir de ces phénomènes extrêmes ?
Comment peut-on anticiper ou atténuer pareils phénomènes, s’ils subvenaient ? »
Bien-sûr que certains diront que cela relève du questionnement-fiction. Pourtant, c’est simplement de la Prospective Stratégique.
La prospective est la démarche qui vise d’une manière rationnelle, créative et holistique, à se préparer aujourd’hui pour demain. Elle ne consiste pas à prévoir l’avenir mais à élaborer des scénarios possibles sur la base de l’analyse des données disponibles (états des lieux, tendances lourdes, phénomènes d’émergences, changements, ruptures, etc.) et de la créativité d’imaginer des futurs possibles.
Ce faisant, ces travaux d’experts qui témoignent des différents futurs possibles, permettent aux décisionnaires, notamment les pouvoirs publics, d’imaginer, voire de créer une vision motivante et à synthétiser les résultats en tant qu’aide à la décision stratégique. Dans des secteurs qui nécessitent un investissement sur le long terme, ou dans la gestion des phénomènes impromptus, mais aux signes avant-coureurs, toutes les Nations modernes sont portées sur la prospective.
Dans la gestion des catastrophes sanitaires par exemple, des plans blancs sont élaborés et mis en veille. Ceux-ci sont activés à la survenue des catastrophes, afin de gérer l’urgence, en attendant d’adapter la prise en charge de la situation en fonction des besoins spécifiques de son ampleur.
Au moins, dans ces premiers instants, souvent critiques et vitaux, chacun sait ce qu’il a à faire et comment le faire. Et cela atténue les bilans humains.
Parlant de plan blanc, comment comprendre que le Congo, un pays qui a connu la catastrophe de Mvoungouti ou encore celle du 4 mars, ne dispose toujours pas de plan blanc de santé et au moindre accident de masse, à l’instar de celui du bus Océan du Nord à Moukondo, près de Dolisie en octobre 2019, on en soit encore à des errements qui, il faut l’avouer, coutent des vies humaines qui auraient pu être sauvées, si les choses s’inscrivaient dans une action prospective. Hélas…
Or, reporté à notre pays, chaque situation de catastrophe est vécue comme si elle était la première. On gère l’urgence avec les errements du fait-accompli, en attendant que retombe la tension. Puis, avec le temps qui passe, la situation sort peu à peu des mémoires, avant de se couvrir de la chape de l’oubli, sans qu’aucune mesure anticipative ne soit projetée face aux cas similaires .
Les récentes inondations l’ont montrées fort à propos, alors que le phénomène revient d’année en année. Il en est de même pour les érosions devenues « dangers urbains de masse ».
Les photo-montage sur la neige au Congo peuvent bien être sujets de divertissement. Pourtant, il est à relever qu’avec le réchauffement climatique, des phénomènes inattendus peuvent subvenir à n’importe quel point du globe.
Depuis bientôt dix ans, l’Afrique du Sud connaît une augmentation exponentielle de chute de neige, la Namibie en recueille des traces.
Chez nous, bien malin celui qui peut encore agencer les saisons sur le calendrier. Les phénomènes climatiques sont soit précoces ou tardifs. Tout est sens dessus-dessous.
En mars 2024, une "vague" de glace de plusieurs dizaines de centimètres a déferlé dans plusieurs villages du district de Mayoko dans le Niari (sud). Cette étrange vague, qui relève d’un phénomène météo aussi rare que singulier, a endommagé plusieurs maisons. Plus de neuf (09) villages sinistrés et des maisons emportées de Tsinguidi jusqu’à Vouka.

Les propriétaires des maisons ont ramassé les restes des blocs de glace qui ont explosé au sol pour les garder comme preuve de ce qui s'est passé. Car cela semble à peine croyable. De Tsinguidi jusqu'à Vouka, nombreux ont également ramassé, pas pour être pris au sérieux par leur assurance, les morceaux de glace éparpillés sur le sol et dans la broussaille, mais pour les présenter en photo ou en vidéo sur les réseaux sociaux. Phénomène en tout cas très rare et hallucinant, du jamais vu au Congo-Brazzaville et dans le département du Niari.
Dans sa célèbre loi de la conservation de la matière, Lavoisier relève que « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Cela devrait nous pousser à remarquer que de nos jours, l’hémisphère nord de notre planète se réchauffe de plus en plus, avec entre autres conséquences, la fonte des glaciers. À l’opposé, l’hémisphère sud grelotte un peu plus.
Et si les degrés de chaleur positive enregistrés au Nord, avaient leur contraire en degrés de chaleur négative au Sud ? Ce qui signifie que cela prendra le temps que ça prendra, l’action dialectique conduira inéluctablement à un ressenti des phénomènes climatiques du Nord au sud et vice-versa.
Les initiateurs des photo-montages sur la neige au Congo, ont présenté les localités sous la neige, en omettant d’adapter l’accoutrement des populations au climat. Les personnes dans les rues, sont présentées avec leur vêtements de tous les jours, adaptés au climat tropical. Dire que c’est justement ce qui se passerait si d’aventure cela se produisait, et avec toutes les catastrophes que le phénomène engendrerait.

Même si les rues seraient désertes, les pullovers de la saison sèche ne couvriraient pas vraiment les corps exposés. Même les produits de consommation ne résisteraient pas à la rudesse des phénomènes.

Et si donc cela arrivait maintenant, y sommes-nous préparés ? Pourquoi ne peut-on pas induire des réflexions prospectives sur ces sujets dits de long terme, mais dont on se surprend que l’échéance perçue comme lointaine finit toujours par arriver, alors qu’on attend Godot.
Bertrand BOUKAKA/Les Échos du Congo-Brazzaville