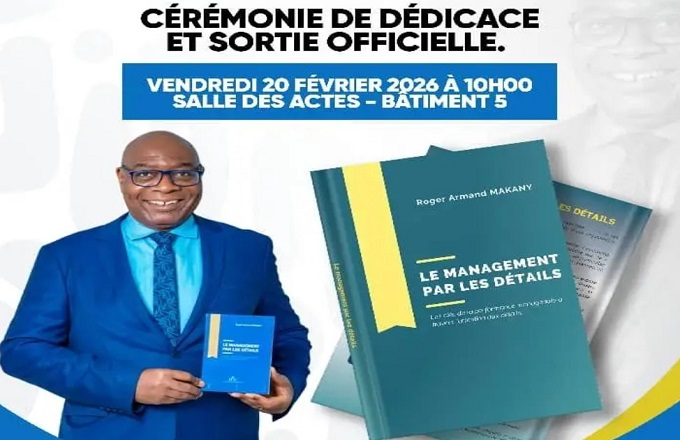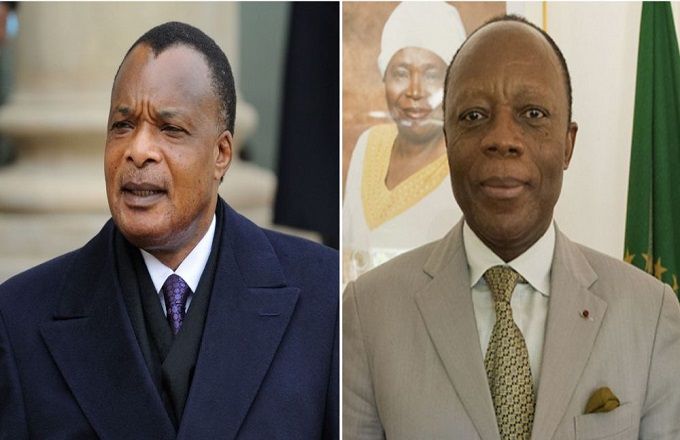La 50e session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’ouvre à Paris dans un monde plus instable que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors que certains régimes imposent la loi du plus fort, bafouant ouvertement le droit international, jamais le besoin de défendre une vision du monde fondée sur le multilatéralisme, la coopération, les libertés publiques, la démocratie et la paix n’a été aussi pressant.
Le Président français, Emmanuel Macron a donné un signal fort en faveur de la Francophonie, à travers ses discours à Ouagadougou, Erevan ou Kinshasa, appelant à une Francophonie jeune, vivante et offensive, et avec l’ouverture de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, véritable manifeste culturel et politique. Ces engagements tracent une ambition claire qu’il faut désormais traduire en actes durables.
Une série de signaux alarmants
Le sommet de Villers-Cotterêts l’a démontré, un élan francophone est encore possible, sous réserve que des actions ambitieuses soient menées. Or, depuis, en quelques mois, plusieurs alertes graves ont ébranlé les fondations de la Francophonie et font douter de la motivation de la France.
Le premier choc est celui du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l’Organisation internationale de la Francophonie. Deuxième alerte, l’accord de paix entre la RDC et le Rwanda, deux piliers du monde francophone, négocié par les États-Unis et le Qatar !! Comment ne pas y voir un effacement diplomatique alarmant ?
S’ajoutent à cela les coupes budgétaires brutales imposées par la France : –75 % pour l’Agence universitaire de la Francophonie, –60 % pour l’Assemblée parlementaire. Un désengagement mal venu et très mal perçu par nos partenaires.
Et, enfin, se pose la question toujours irrésolue des visas, qui mine la réputation de la France. Le refus d’entrée, très médiatisé, du Dr Moctar Touré, Président de l’Académie des Sciences du Sénégal et figure du monde scientifique africain, décoré par la République française, en est un symbole tragique. Ce type de décision contredit l’esprit de partage des savoirs que nous affirmons incarner.
Une question brutale : La France a-t-elle tourné le dos à la Francophonie ?
Ce triple recul — diplomatique, politique, budgétaire — pose une question simple et brutale : la France a-t-elle réellement renoncé à ce qu’elle a contribué à bâtir ? Nous, signataires de cette tribune, refusons de nous y résoudre.
Car ce qui est en jeu dépasse la langue, l’histoire ou les institutions. C’est le modèle de société que nous défendons : un espace fondé sur l’État de droit, l’égalité, la liberté, le dialogue des cultures.
Dans ce contexte troublé, il convient de saluer le courage de celles et ceux qui, malgré les vents contraires, continuent de défendre la Francophonie avec fidélité aux valeurs qu’elle porte. Le ministre Thani Mohamed Soilihi en est un exemple, refusant de céder à la fatalité budgétaire qui lui est imposée.
Il est encore temps d’inverser la tendance. À condition de le vouloir, et d’agir maintenant, en suivant un plan d’action précis.
Premièrement, renouer avec une véritable vision politique.
La France doit assumer ses responsabilités et jouer pleinement son rôle de leader et d’inspirateur. Cela suppose un cap clair, une constance dans l’engagement et des actes concrets forts. Le rapport de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, paru la semaine dernière, en trace les grandes lignes.
La Francophonie doit rapidement redevenir un axe structurant de notre diplomatie, porté par l’État, relayé par les élus, les institutions, les collectivités, mais aussi par la diplomatie parlementaire, qui peut jouer un rôle déterminant pour retisser les liens entre les peuples. C’est sans doute aujourd’hui l’axe le plus porteur pour affirmer durablement notre influence à l’international.
Deuxièmement, redéfinir une nouvelle ambition mobilisatrice.
La Francophonie du XXIème siècle ne peut se résumer à un héritage. En plus d’un modèle de société, elle doit devenir une promesse d’avenir pour la jeunesse francophone : apprendre, entreprendre, créer, rêver ou même chanter. En « Francophonie », chacun doit trouver sa place, sa voix, son avenir.
Cela suppose une rupture nette avec le passé : sortir d’une vision datée, héritée, pour construire une Francophonie porteuse de nouvelles utopies. Là encore, il ne s’agit pas de repartir de zéro, mais de donner à cette ambition un souffle nouveau, plus concret, plus lisible.
Troisièmement : mettre en place des règles de mobilité claires.
Il ne peut y avoir d’espace francophone facteur de développement sans règles claires de mobilités des personnes. Des initiatives en la matière existent, mais restent trop dispersées, peu visibles, et parfois défaites par des pratiques administratives contre-productives. Il est temps de faire de la mobilité un levier stratégique.
Quatrièmement : moderniser les outils et transformer la gouvernance.
Plusieurs opérateurs de la Francophonie ont su se réinventer, innover, se rapprocher du terrain. Ces dynamiques doivent être soutenues et généralisées pour bâtir une gouvernance francophone plus inclusive, plus ouverte, plus agile, et où les diasporas, les territoires, les créateurs, les universités, les collectivités et tous les acteurs de terrain seraient associés aux grandes orientations.
La France doit y jouer pleinement son rôle. Non pas en s’imposant, mais en engageant. Non pas en centralisant, mais en fédérant. Non pas en parlant seule, mais en donnant la parole aux autres.
Une vocation à réaffirmer d’urgence
« La France n’est réellement elle-même qu’au premier rang ». Cette phrase du général de Gaulle nous rappelle notre vocation : être à la hauteur des causes que nous prétendons servir.
Réinvestir le projet francophone n’est ni un luxe ni un supplément d’âme. C’est une nécessité stratégique et civilisationnelle ; pour continuer d’être plus grand que ce que nous sommes – ou courir le risque de disparaître à force de renoncements et d’idées étriquées.
Une Francophonie sans la France s’efface. Une France sans Francophonie perd sa voix.
L’heure est venue de choisir : Qui veut agir, nous suive !

Bruno Fuchs, président de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale

Jean Pierre Raffarin, Ancien Premier ministre, ancien représentant personnel du Président de la République pour la Francophonie

Jean Marie Bockel, Ancien ministre de la Coopération et de la Francophonie, Vice-président du groupement du patronat francophone

Christian Philip, Ancien représentant personnel du Président de la République pour la Francophonie, président du Réseau International des Maisons de la Francophonie
Les Echos du Congo-Brazzaville
Photos : DR