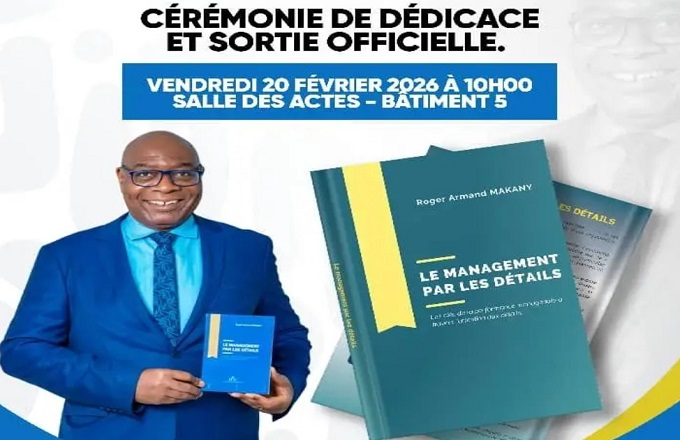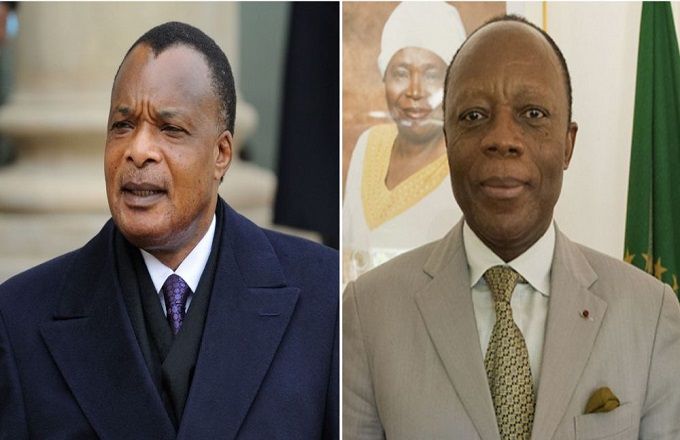Depuis le jeudi 12 juin, Israël et l’Iran sont entrés dans une guerre ouverte dont les conséquences peuvent avoir des répercutions planétaires. Si partout ailleurs, les inquiétudes montent et les pouvoirs publics s’ingénues à tenter de trouver des solutions aux effets qui outre les aspects sécuritaires, induiraient cette guerre, en Afrique, l’organisation continentale et la quasi-totalité des États assistent au conflit à la télévision, attendant d’être placés devant le fait accompli, plutôt que d’anticiper sur les effets politiques et économiques de la situation.
Une guerre aux conséquences imprévisibles
La guerre déclarée entre Israël et l’Iran depuis soulève des inquiétudes non seulement dans la région du Moyen-Orient, mais aussi dans le reste du monde.
L’un des aspects les plus préoccupants est la potentielle fermeture du détroit d’Ormuz, une voie maritime vitale pour le transport de pétrole et de gaz naturel.
Environ 20 % de la consommation mondiale de pétrole et plus de 25 % des échanges de gaz naturel liquéfié passent par ce passage stratégique.
Sa fermeture pourrait engendrer des répercussions économiques cataclysmiques à l’échelle mondiale.
Le détroit d’Ormuz, situé entre Oman et l’Iran, est souvent décrit comme l’une des voies maritimes les plus stratégiques du monde. Ce passage n’est pas seulement un point névralgique pour le commerce du pétrole; il est également au cœur des tensions géopolitiques entre différents États de la région.
Actuellement, l’Iran, qui contrôle le côté nord du détroit, a souvent menacé de bloquer ce passage en réponse à des hostilités perçues, notamment des sanctions occidentales ou des actions militaires israéliennes.
La tension entre Israël et l’Iran ne se limite pas à une simple rivalité nationale; elle implique une multitude d’acteurs régionaux et internationaux. Israël, avec son alliance étroite avec les États-Unis et d’autres pays occidentaux, voit l’Iran comme une menace majeure en raison de son programme nucléaire et de son soutien à divers groupes militants au Proche-Orient.
De l’autre côté, l’Iran a renforcé ses alliances avec des pays comme la Syrie et des organisations comme le Hezbollah, augmentant ainsi la complexité du conflit.
Et les africains dans tout cela ?
Au plan politique, c’est le flou total. Soit par manque de courage de ses alliances, ou simplement par défaut d’alignement lié à une dépendance vis-à-vis des tiers, qui n’incite guère à se déterminer.
Sur le plan économique dont les conséquences seront les plus visibles et impacteront surtout les populations les plus fragiles et qui le sont déjà, là non-plus, aucune prospective, comme avec la guerre Russie – Ukraine, quand on a attendu d’être confronté au prix des céréales, pour comprendre que ce conflit opposant deux pays européens, avait aussi des conséquences en Afrique.
Pourtant, jamais on en tire des leçons comme si l’Afrique ne disposait pas des intelligences à même d’entrevoir « une approche rationnelle et holistique , à préparer le futur » des africains, pour reprendre les mots de Gaston Berger.
Les ramifications d’une fermeture du détroit d’Ormuz seraient considérables, car affectant de nombreux secteurs.
Répercussions économiques
Les prix du pétrole pourraient atteindre des sommets vertigineux si l’approvisionnement était interrompu, affectant tout, des prix à la pompe aux coûts de production. Pour de nombreux pays africains qui exportent davantage de brut qu’ils n’en raffinent, les effets seraient catastrophiques.
Instabilité régionale
Le blocage du détroit entraînerait une escalade militaire qui pourrait impliquer plusieurs pays, aggravant les conflits existants. L’Afrique subirait indûment les conséquences multiformes d’un jeu d’alliance dont elle ne tire presque rien.
Conséquences pour les chaînes d’approvisionnement
Les entreprises multinationales pourraient faire face à des défis logistiques importants, affectant leur production et leur rentabilité ainsi que les coût y relatifs. Grande importatrice des produits manufacturés, même des biens de consommation de première nécessité, l’Afrique agoniserait très vite, avec des produits hors de prix que les États aux économies déjà fragiles, ne pourront pas subventionner.
Un conflit susceptible de redessiner un nouvel ordre mondial
La fermeture du détroit d’Ormuz aurait également des répercussions géopolitiques significatives. Les alliances et rivalités dans la région seraient profondément modifiées, induisant un nouvel ordre mondial, avec une redéfinition des relations diplomatiques.
Des alliances inattendues pourraient émerger, menaçant l’équilibre régional, déclenchant des affrontements directs entre divers pays.
La raison d’être de l’’Union africaine
Portée à bout de bras aussi bien dans les discours politiques qu'économiques, la création de l'Union africaine était considérée comme un événement majeur dans l'évolution politique et institutionnelle du continent. Elle apparaissait pour le continent, comme une institution miracle chargée de trouver des solutions aux multiples problèmes à travers la technique de l'intégration.
Effectivement, le 09 septembre 1999, les chefs d'Etats et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine avaient adopté une déclaration, la Déclaration de Syrte, demandant la création de l'Union Africaine en vue, entres autres, d'accélérer le processus d'intégration sur le continent afin de permettre à l'Afrique de jouer le rôle qui lui revient dans l'économie mondiale, tout en déployant des efforts pour résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques multiformes auxquels elle est confrontée, problèmes accentués par certains effets négatifs de la mondialisation.
L’organisation panafricaine est investie d'une mission de grande envergure afin de répondre aux défis d'une mondialisation de plus en plus hors de portée, a, plus que jamais, ressuscité la problématique de l'intégration africaine sous une dimension originale qui hélas, tarde à répondre aux défis qui se font jour.
Dans ce contexte préoccupant de la guerre Israël – Iran et les conséquences qu’elle peut engendrer, les africains devrait envisager toutes les éventualités.
Pourtant, comme toujours, l’Afrique regarde passer les trains, sans monter dans aucun d’eux, jusqu’à ce que plus aucun train ne passe, retardant ainsi le rendez-vous avec sa propre histoire, celle conçue et écrite par des africains.
C’est des grandes crises que naissent les grandes idées. Jusqu’à quand les africains seront-ils à court d’idées ?
Bertrand BOUKAKA/Les Échos du Congo-Brazzaville